Entretien avec Judith Rainhorn

Entretien avec Judith Rainhorn, professeure au Centre d'histoire sociale (CHS) et titulaire de la Chaire Santé-SHS
Son dernier livre, Blanc de plomb. Histoire d'un poison légal, est paru en 2019 aux Presses de Sciences Po.
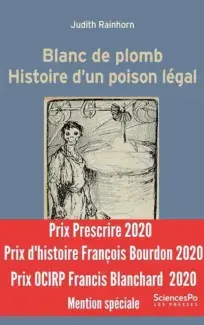
Sur quoi portent vos recherches actuelles ?
Les recherches que je mène depuis une dizaine d’années désormais se situent à l’intersection entre l’histoire des villes, l’histoire du travail et l’histoire de la santé. Dans mon dernier livre, je me suis intéressée au plomb. Le plomb, c’est un peu ce bon vieux produit familier que tout le monde connaît (y compris dans des expressions populaires : ne dit-on pas qu’il faut mettre du plomb dans la tête des enfants négligents ?) et dont nous savons pourtant qu’il est dangereux pour la santé.
J’ai essayé de comprendre cette énigme historique : comment a-t-on encouragé, à partir de l’ère industrielle, la fabrication et l’usage massif du plomb, en particulier dans la peinture en bâtiment, alors même que l’on savait parfaitement que cette substance était dangereuse ? D’où l’expression que j’ai employée de « poison légal » pour désigner une substance que l’on sait toxique pour la santé humaine, animale et pour l’environnement et dont on tolère cependant (et dont on encourage même) le développement sur le marché. Il y a beaucoup de poisons légaux, aujourd’hui comme hier, que l’on pense à l’amiante pendant le XXe siècle, aujourd’hui au glyphosate ou aux « polluants éternels ». Dans quelle mesure les sociétés contemporaines s’accommodent-elles de ces « poisons légaux » ? C’est cette question historique qui m’intéresse.
J’évoque ces recherches récentes dans un entretien avec Mathias Girel.
L'ouvrage de Judith Rainhorn, Blanc de plomb. Histoire d'un poison légal, paru en 2019, a reçu plusieurs prix, dont le Prix "Prescrire" 2020. Il a fait l'objet de nombreux comptes-rendus, notamment dans Le Monde des livres, Le Mouvement social, La Nouvelle revue du travail ou encore Lectures.
Comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux questions de santé et d’environnement dans votre parcours de recherche ?
J’ai fait ma thèse (soutenue en 2001) sur l’histoire comparée des migrations internationales en France et aux États-Unis. Cela m’a amenée à m’interroger sur le travail des migrants, qui sont le plus souvent engagés dans les secteurs les plus dangereux : j’ai rencontré la question de l’environnement de travail, des accidents et des maladies liées à l’activité professionnelle, en particulier dans l’industrie.
C’est ainsi que, travaillant sur des espaces industriels comme Paris, New York ou encore le Nord de la France au XIXe siècle (mines, métallurgie, industrie textile, etc.), j’ai été confrontée à la question des usines toxiques, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’usine : quelles étaient (et quelles sont encore) les nuisances et les pollutions imposées aux travailleurs et travailleuses et aux populations vivant autour des usines ? Comment ces populations (ce sont souvent les mêmes) ont-elles réagi à l’égard de ces nuisances ? Quels acteurs et actrices se sont mobilisés sur ces enjeux de santé et d’environnement urbain ? Comment comprendre l’alternance de phases de visibilité et de périodes d’invisibilité de la question des pollutions dans le débat public ? Voilà, en vrac, les questions qui guident mes recherches aujourd’hui.
Comment intégrez-vous ces problématiques aux enseignements que vous dispensez à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ?
Il me semble fondamental de transmettre les résultats et, plus encore, les questionnements de la recherche en train de se faire au sein de mes enseignements. En licence, j’essaie de sensibiliser les étudiants et étudiantes à la non-linéarité des chronologies : je pense qu’il faut se défaire de l’idée selon laquelle il y a un « progrès » général depuis le XIXe siècle des savoirs, des mobilisations populaires, de la législation protectrice au travail et dans l’environnement. C’est une idée très rassurante, car on a l’impression qu’on va vers une amélioration constante, qu’on est maintenant très conscient collectivement des dangers portés par certains produits ou procédés et que, par conséquent, tout va mieux. Et pourtant ! Les processus se répètent, comme on le voit avec les toxiques contemporains qui restent en circulation alors que l’on connaît leur dangerosité (pesticides, produits ménagers, particules fines de diesel, etc.). Pourquoi reconstruit-on le toit de Notre-Dame de Paris en plomb, alors que l’on sait que l’incendie de 2019 a produit un nuage toxique sur une partie de la capitale et que l’usage du plomb sur le chantier de reconstruction de la cathédrale met aujourd’hui en danger les ouvriers qui y travaillent ?
J'essaie de faire varier les formes de restitution des savoirs acquis par les étudiants au cours des enseignements, en leur proposant de réaliser des podcasts audio ou des capsules vidéos sur des sujets touchant à l'histoire de la santé.
En master et en doctorat, il convient de former les jeunes chercheurs et chercheuses aux développements récents de l’historiographie sur les questions de santé et d’environnement, et ils sont nombreux depuis vingt ans. C’est très stimulant !
Dans quelle mesure pensez-vous que l’histoire peut contribuer à la réflexion sur les grands enjeux sanitaires et environnementaux contemporains ?
Dans la multiplicité des disciplines qui se saisissent des enjeux sanitaires et environnementaux, l’histoire a un rôle particulier à jouer. En donnant de la profondeur chronologique à la réflexion, l’histoire permet de comprendre l’origine des phénomènes contemporains, les processus de construction des équilibres (ou des déséquilibres) entre les acteurs. Faire l’histoire longue du rapport au corps permet de mettre en lumière les phénomènes de médicalisation des sociétés depuis deux ou trois siècles et de questionner la comparaison entre des espaces sociaux et géographiques différents. Étudier sur le temps long le développement de l’institution hospitalière par exemple, Foucault l’a montré en son temps, est fondamental pour comprendre la place que cet espace de soins a pris dans la société contemporaine et la gravité du désinvestissement actuel de l’État dans un certain nombre de pays marqué par des politiques de libéralisation de la santé. En bref, l’histoire apporte de la complexité à la réflexion, ce qui est toujours précieux.
Quelle place accordez-vous à l’interdisciplinarité et au travail collectif dans votre pratique de recherche ?
On est toujours plus intelligent à plusieurs ! En confrontant les points de vue, on enrichit considérablement les perspectives et les enjeux sanitaires et environnementaux sont nécessairement pluridisciplinaires.Les questions de santé et d’environnement sont très largement travaillés par des sociologues, des philosophes, des politistes, des juristes, etc., sur des objets communs.
Par exemple, la question des pollutions a d’abord été abordée par les sociologues, les économistes et les géographes qui ont décrit les pollutions contemporaines, avant qu’on ne s’intéresse à la construction du droit en la matière, puis que les historiens et historiennes s’intéressent enfin à la construction de la pollution comme question publique et aux débats et mobilisations sur les nuisances industrielles depuis la fin du XVIIIe siècle.
L’interdisciplinarité doit également être tentée entre sciences humaines et sociales d’une part et médecine, biologie, pharmacie, etc., d’autre part. C’est un vrai défi, tant les cultures de travail sont différentes, mais c’est le plus souvent passionnant sur des objets comme la respiration, les addictions, ou encore l’alimentation, par exemple. C’est aussi l’objet de cette chaire de recherche de l’université Paris 1.