Entretien avec Aurore Koechlin

Entretien avec Aurore Koechlin, sociologue, maîtresse de conférences au Cetcopra
Membre du Centre d'étude des techniques, des connaissances et des pratiques et du bureau du RT 41 « Corps, technique et société » de l’Association Française de Sociologie, Aurore Koechlin co-dirige la collection « Le genre du monde » des Éditions La Dispute, avec Danièle Kergoat et Pauline Delage.
Son dernier livre, La norme gynécologique. Ce que la médecine fait au corps des femmes, est paru en 2022 aux Éditions Amsterdam.
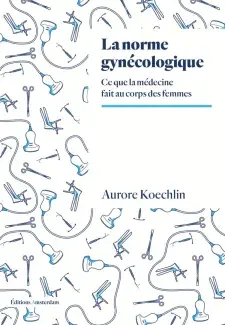
Sur quoi portent vos recherches actuelles ?
Depuis une dizaine d’années, mes travaux portent sur la gynécologie médicale, et plus précisément sur ce que j’ai appelé la « norme gynécologique », soit la norme qui enjoint aux femmes à consulter un ou une professionnelle de santé pour la contraception et pour le dépistage.
Quatre aspects m’interrogent tout particulièrement : 1) le fait qu’il s’agisse d’une norme médicale genrée, puisque l’équivalent pour les hommes, soit l’andrologie, n’existe pas dans les mêmes proportions ; 2) le fait qu’elle consiste en une médicalisation du corps sain, puisqu’il s’agit d’une prise en charge sans motifs apparents nécessaires ; 3) le fait qu’elle instaure une temporalité spécifique, soit un « suivi » idéalement annuel et tout au long de la vie ; 4) enfin, le fait qu’elle concerne une part importante de la population, puisque selon les données de l’enquête Fécond traitées par Mireille Le Guen, 90 % des femmes interrogées ont un gynécologue ou un médecin qui les suit habituellement pour la contraception ou d’autres raisons gynécologiques, et 79% de ces femmes ont consulté il y a moins d’un an. De telles caractéristiques peuvent se retrouver dans d’autres spécialités médicales, mais jamais de façon conjuguée comme c’est le cas pour la gynécologie. Or, malgré ces particularités, la norme gynécologique demeure peu interrogée : d’où vient-elle ? Comment s’est-elle instaurée ? Quels sont ses effets ?
Pour y répondre, j’ai réalisé une thèse intitulée Suivre et être suivie. L’émergence, la consolidation et la déstabilisation de la norme gynécologique en France (1931-2018), soutenue en 2021, dans une double perspective socio-historique et ethnographique. Je me suis ainsi appuyée sur trois types de matériaux – des imprimés et des archives (officielles et personnelles), des observations multi-situées à Paris et en Seine-Saint-Denis en hôpital (deux terrains) et en cabinet (deux terrains), et enfin des entretiens avec des professionnel·le·s de santé (n= 50) et des patientes (n= 46).
Je montre ainsi trois raisons centrales au succès de la norme gynécologique. Tout d’abord, elle parvient à émerger puis à s’imposer en France en lien avec le développement d’une profession, celle des gynécologues médicales, à la position ambiguë dans la hiérarchie professionnelle, c’est-à-dire dominée mais disposant d’importantes ressources. La plasticité des stratégies de reconnaissance professionnelle qu’elle déploie au fil du temps assure le succès de la norme gynécologique malgré les crises que traverse par ailleurs la spécialité. Elle parvient ainsi à fixer l’identité professionnelle de la gynécologie médicale, si ce n’est comme « féministe », du moins comme une spécialité de femmes pour les femmes. Ensuite, la norme gynécologique peut prendre appui sur deux autres normes, la norme contraceptive et la norme préventive, qui garantissent non seulement l’entrée des femmes dans la carrière gynécologique, mais encore son maintien tout au long de la vie. Enfin, naturalisée et invisibilisée, articulée à la médicalisation plus globale des corps des femmes, d’une part, et à la délégation plus vaste à ces dernières des tâches de santé, de l’autre, la norme gynécologique n’est pas perçue comme telle par les femmes auxquelles elle s’applique.
J’ai ainsi pu dessiner un modèle gynécologique français, avec une entrée dans la carrière gynécologique synonyme d’entrée dans l’hétérosexualité et dans la contraception, et une poursuite de la carrière idéalement tout au long de la vie, jusqu’à la mort. J’ai interrogé plus spécifiquement ce lien entre norme gynécologique et norme (hétéro)sexuelle dans un article de 2022 intitulé « La consultation gynécologique, une instance paradoxale dans la socialisation des jeunes femmes à la sexualité ».
Si je n’ai pas constaté au sein de la consultation « ordinaire » des contestations frontales de la norme gynécologique, la multiplicité des configurations existantes vient nuancer une analyse qui pourrait sembler d’abord trop unilatérale du côté de l’inflexibilité de la norme : les appropriations profanes demeurent ainsi nombreuses. Je les ai tout particulièrement étudiées en réalisant un petit terrain sur les praticiennes de l’auto-gynécologie, dont j’ai rendu compte en 2019 dans un article intitulé « L’auto-gynécologie féministe : écoféminisme et intersectionnalité ».
Comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux questions de santé dans votre parcours de recherche ?
Ma formation initiale portait surtout sur le genre, puisque j’ai d’abord réalisé un master de littérature, et je suis venue à la sociologie par le biais du genre, après une spécialisation en études de genre. Très vite pourtant, c’est le lien entre sociologie du genre et sociologie de la santé qui m’a tout particulièrement intéressée. De fait, c’est un sous-domaine de la sociologie du genre particulièrement dynamique. Quand j’ai commencé à travailler sur la gynécologie, au milieu des années 2010, c’était dans un contexte d’effervescence et de renouveau des recherches autour de la contraception et de l’avortement. On voyait émerger une nouvelle génération de chercheuses et de chercheurs, souvent au croisement de la sociologie et de l’histoire, qui renouvelait les approches sur les mobilisations autour de la santé des femmes dans les années 1970 (Garcia 2011, Pavard 2012, Ruault 2017 (voir aussi le livre en 2023), Sanseigne 2019), qui retraçait l’émergence du modèle contraceptif français centré sur la pilule (Roux, 2020, voir aussi le livre paru en 2022), qui analysait ses manifestations contemporaines (Fonquerne, 2021), ou interrogeait la « crise de la pilule » (Rouzaud-Cornabas, 2019), enfin qui mettait à jour des aspects inexplorés de la sociologie de la contraception – comme la contraception masculine (Ventola, 2017) ou le lien entre contraception et sexualité (Thomé, 2019). Parallèlement, les pratiques contemporaines de l’avortement étaient elles-mêmes l’objet de nouvelles recherches, en comparaison avec d’autres pays (Mathieu, 2016), en travaillant sur le maintien d’une stigmatisation de l’avortement malgré sa légalisation (Thizy, 2023), ou en étudiant plus spécifiquement les professionnel·le·s de santé face à l’avortement (Perrin, thèse en cours). Dans ce contexte, la gynécologie s’est vue aussi interrogée à nouveaux frais, soit par les travaux que je viens de citer, soit par d’autres, portant notamment sur l’auto-gynécologie (Quéré, 2021, voir aussi le livre en 2023), ou l’endométriose (Millepied thèse en cours, Nève thèse en cours). C’est donc tout naturellement que je me suis insérée dans ce dynamisme collectif, dont est également le reflet la création en 2017 du laboratoire junior Contraception & Genre, dont je suis membre.
Comment intégrez-vous les problématiques de santé et d’environnement aux enseignements que vous dispensez à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ?
Je donne un cours intitulé « Sexe et genre », dans lequel je reviens sur l’histoire, le développement et la réception dans des champs différenciés des grands concepts de la sociologie du genre – sexe, genre, sexualité, queer, la triade classe/genre/race, intersectionnalité, …). Dans ce cadre, je reviens tout particulièrement sur le rôle de la médecine dans l’élaboration du concept de genre, mais aussi l’importance des critiques féministes qui ont pu être opposées à la médecine et à la médicalisation. J’interroge, en revenant sur le concept de « sexe », le processus de naturalisation et de biologisation de la domination. Pour ce faire, je mobilise mes propres recherches, mais également les travaux contemporains au croisement de la sociologie du genre et de la santé.
Dans quelle manière liez-vous travail académique et engagement militant, en particulier dans le domaine de la santé ?
Tout d’abord mon intérêt pour l’objet vient d’un engagement féministe antérieur, j’ai donc toujours en partie lié les deux, non dans la réalisation de ma recherche ou dans ses conclusions, mais en participant à ces deux espaces simultanément. C’est ainsi que j’ai publié en 2019 aux éditions Amsterdam un essai intitulé La révolution féministe, alors que je réalisais en parallèle mon travail de thèse. Aujourd’hui ma façon de conjuguer les deux est de tout faire pour rendre mes recherches accessibles à un public de non spécialistes, qui soit le plus large possible. C’est pourquoi j’ai publié en 2022 la partie ethnographique de ma thèse dans un format qui se voulait non universitaire, toujours au éditions Amsterdam, La norme gynécologique. Ce que la médecine fait au corps des femmes. Cela passe également par une promotion active de ma recherche, en jouant le jeu des médias, ou en faisant des rencontres en librairies ainsi que des communications dans des espaces militants. Enfin, fait notable, j’ai également été invitée à présenter mes résultats dans des cadres médicaux (tables-rondes, congrès), puisque les professions médicales ont beaucoup lu mon ouvrage, en particulier les sage-femmes. J’espère ainsi pouvoir contribuer, comme je le disais en exergue de mon livre, à bâtir un monde du soin plus juste.