
Récentes publications en lien avec la santé (ouvrages, revues, articles...) :
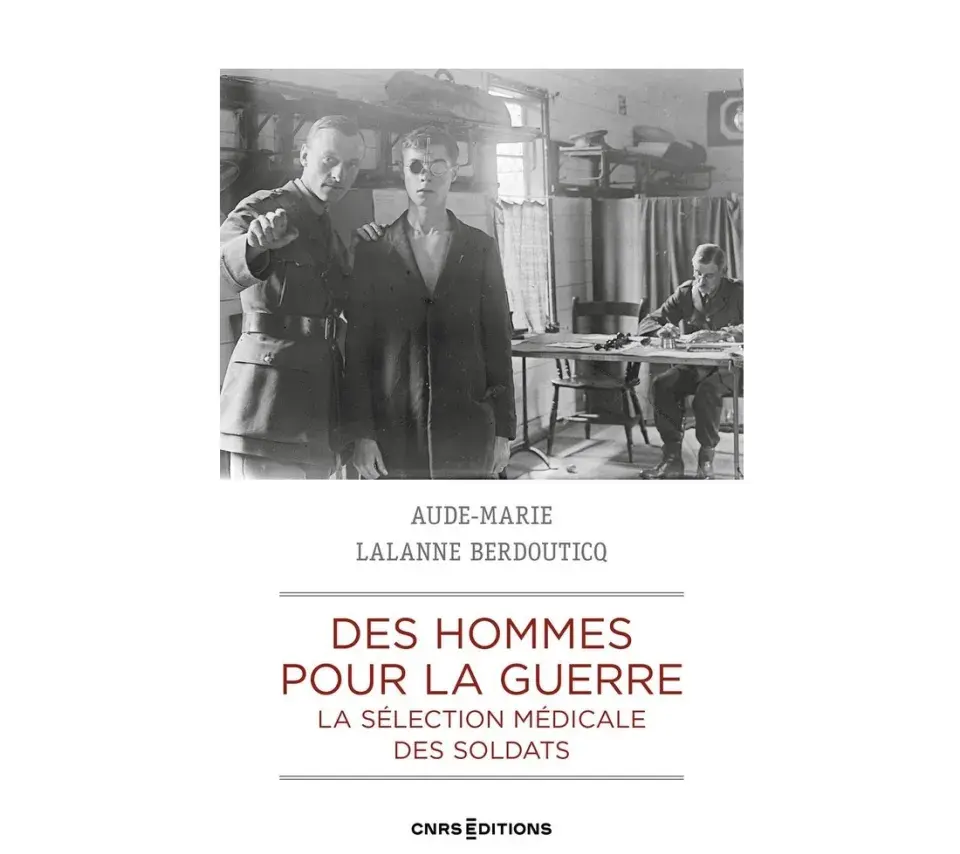
Des hommes pour la guerre. La sélection médicale des soldats
« Quelles doivent être les aptitudes du soldat ? » Dans l'ouvrage issu de sa thèse de doctorat, Des hommes pour la guerre, l'historienne Aude-Marie Lalanne-Berdouticq explore les processus de sélection médicale des soldats français et britanniques pour comprendre l'évolution de la notion d'« aptitude » en France et en Grande-Bretagne de manière comparée.
Abordant ce processus comme une construction sociale et politique, l'historienne replace la sélection médicale dans des débats plus anciens mobilisant les sphères savantes et médicales à partir des années 1890 (première partie). Le processus connait des transformations profondes au cours de la Première Guerre mondiale. La nécessité de recruter un nombre croissant d'hommes dans un conflit de plus en plus long et coûteux contraint à adapter les principes du recrutement (deuxième partie). Un examen minutieux de l'activité et des savoirs du corps médical permet de montrer les praticiens au travail et la manière dont ils gèrent, en interaction avec le corps de l'armée, les différentes contraintes techniques, sanitaires et militaires liées au recrutement. L'historienne montre enfin comment ces choix marquent les sociétés françaises et britanniques et résonnent en-dehors des sphères médicales et militaires, en temps de guerre comme en temps de paix (troisième partie). L'élargissement des principes de sélection nourrit un certain nombre de débats et de craintes autour des questions posées par la préservation du corps social (dépopulation, théorie de la dégénérescence). Dans des sociétés fragilisées par la guerre, ces mêmes débats favorisent l'investissement de l'État en faveur du développement de la protection sociale, de la statistique et d'une anthropologie marquée par des discours eugénistes.
Lalanne Berdouticq, Aude-Marie, Des hommes pour la guerre : La sélection médicale des soldats, Paris, CNRS Éditions, collection « Nationalismes et guerres mondiales », 2025, 460 p.
EAN : 9782271152077
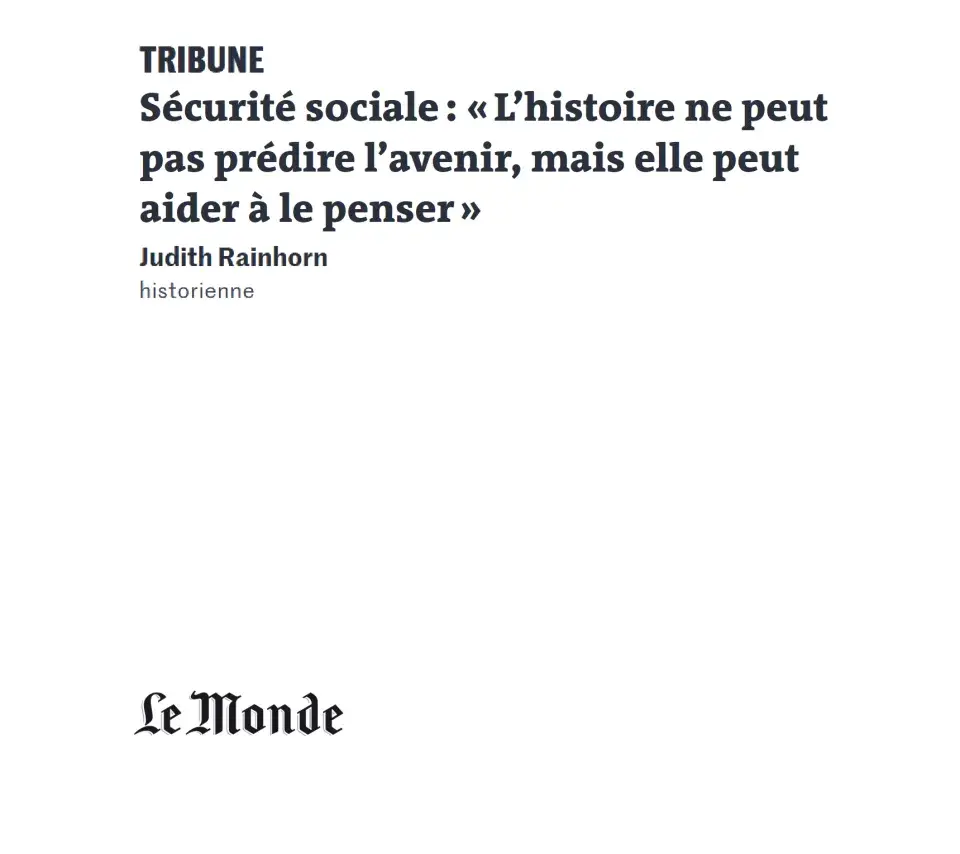
Sécurité sociale : « L’histoire ne peut pas prédire l’avenir, mais elle peut aider à le penser » (Tribune)
« Autant célébrée et autant critiquée ». Tel est le constat que dresse l'historienne Judith Rainhorn à l'occasion des 80 ans de la naissance de la Sécurité sociale en France. Dans la tribune qu'elle a publiée dans Le Monde, ce samedi 4 octobre 2025, la présidente du conseil scientifique du comité d'histoire de la Sécurité sociale revient aux origines de l'institution et rappelle quels ont été ses apports dans la construction du modèle français de redistribution et la garantie d'une solidarité intergénérationnelle.
Né à partir des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, le système collectif de protection social s'inscrit dans l'histoire plus longue de l'assistance et de la lutte contre la pauvreté et la précarité. La naissance de l'institution est fille d'un mouvement interventionniste en matière sociale qui a vu naître les lois permettant la prise en charge des accidents du travail (1898), des maladies professionnelles (1919) ou encore le congé de maternité indemnisée pour les salariées (1913). L'année 1945 marque un tournant dans ce mouvement : la Sécurité sociale entend rompre avec l'assistance fragmentée et a pour ambition de couvrir l'ensemble de la population face à des risques plus étendus (au-delà du travail) : maladie, vieillesse, famille...
Depuis, la Sécurité sociale a rallongé l'espérance de vie des populations, amélioré considérablement le niveau de vie de plusieurs foyers et cimenté le lien social. Alors que plusieurs lignes de fracture amènent à interroger l'avenir de ce système d'entraide collective et obligatoire (crises, augmentation des coûts de santé, montée des emplois précaires), l'historienne Judith Rainhorn réaffirme la nécessité de penser son principe fondateur : celui de la solidarité.
L'article est consultable en intégralité à partir du lien suivant : TribuneSécuritésociale.pdf (pour les non-abonné.e.s au journal Le Monde).
Il est également accessible ici (pour les abonné.e.s du journal).
Sa lecture peut être complétée à partir des articles complémentaires « Il n'y a pas de fatalité à laisser détruire notre patrimoine commun » et « Un outil pour sécuriser l'avenir » publiés respectivement par Léo Rosell (doctorant en histoire à l'université de Bourgogne) et Giacomo Canepa (chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po). Elle peut encore être complétée à partir de la lecture du numéro scientifique, dédié au "moment 1945", publié dans la Revue d'Histoire de la Protection Sociale (2025/1 n°18).
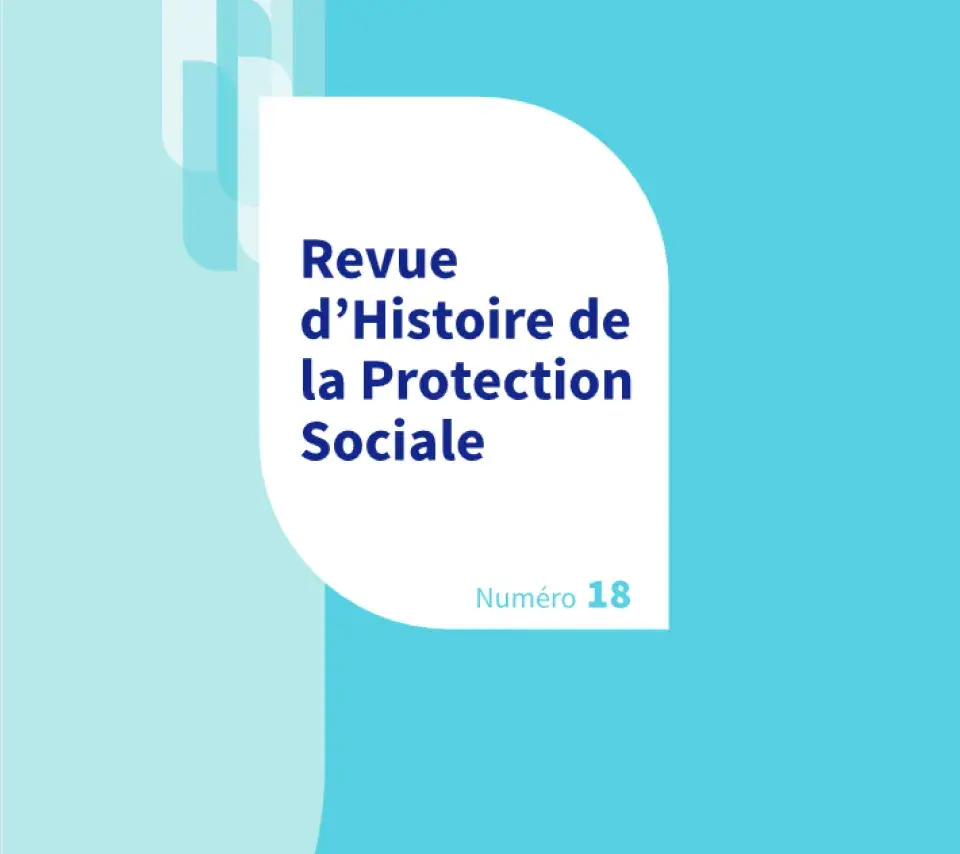
« Le "Moment 1945"». Parution du nouveau numéro de la Revue d'Histoire de la protection sociale (2025/1 n°18)
À l'occasion du 80e anniversaire de l'instauration de la Sécurité sociale en France, la Revue d'histoire de la protection sociale propose de revenir aux origines de ce système de l’État-providence adopté dans plusieurs pays industrialisés pour protéger leurs citoyens contre les risques sociaux. Le présent numéro propose de se concentrer sur le moment fondateur de l'année 1945 et propose ainsi une suite au numéro publié en 2016 (n°9) sur « Grande Guerre et protection sociale ».
Ce numéro réunit plus d'une dizaine d'historiens et d'historiennes français.e.s et étranger.ères et propose d'interroger différents pays, depuis les cas de la Belgique (Quentin Detienne, Éric Geerkens), l'Italie (Paolo Mattera) ou encore la Tchécoslovaquie (Jakuk Rákosník, Radka Šustrová) en passant par le Japon (Bernard Thomann). Attentif à la diversité des trajectoires nationales et au poids des héritages, le dossier souligne la diversité des contextes et des débats entourant l'instauration des régimes de sécurité sociale tout en s'intéressant aux contingences et aux limites des changements opérés.
Le dossier est complété par une anthologie de textes de Pierre Laroque, « père » de la Sécurité sociale française, rassemblés et présentés par Michel Laroque, différents hommages ainsi que des comptes-rendus de publication et des activités de l'association et du Comité d'histoire de la Sécurité sociale.
Le numéro est librement consultable ici.
« Le "Moment 1945" », Revue d'histoire de la protection sociale, 2025/1, n°18, 255 p.

Parution du nouveau numéro de la revue Histoire, médecine et santé (N°27)
La revue semestrielle Histoire, médecine et santé (HMS) vient de publier son 27ème numéro pour l'été 2025 : "Les moulages médio-pathologiques en cire". Dirigé par Alexandre Wenger (Professeur de Medical Humanities en Faculté de médecine), ce numéro entend dépoussiérer des artéfacts médicaux vieux de plus d'un siècle : les anciens moulages médicaux en cire.
Produits de l'art, de la science et de la pédagogie, les moulages constituent des interfaces privilégiés pour étudier les corps, les techniques et les idées du passé. Face à une demande sociale croissante, le présent numéro entend renouveler leur étude en explorant de nouveaux horizons : production et usages en contexte colonial, à des fins de propagande antivénérienne, expositions... À cette fin, Alexandre Wenger a collaboré avec plusieurs spécialistes dont des historiens de l'art (Sophie Delpeux, Kathleen Pierce), des sciences (Christian Bonah) et de la médecine.
Le numéro est librement consultable ici.
"Les moulages médico-pathologiques en cire. Objets d'art, de savoirs et d'enseignement (fin XIXe-XXIe siècle)" Medical-Pathological Wax Moulages : Objects of Art, Knowledge and Teaching (late 19th to 21st century)
ISBN 978-2-8107-1333-2

Saturnisme sur le chantier de l’Opéra royal de Versailles : « Même au XXIᵉ siècle, on dénie la dangerosité des produits toxiques qui nous entourent, en particulier au travail » (Tribune)
Malgré une réglementation stricte, la présence et la toxicité du plomb sont est-elles condamnées à être négligées dans le monde du travail ? Devant cette question ancienne et source de nombreuses controverses, le tribunal judiciaire de Versailles vient de rendre un jugement exemplaire. L'historienne Judith Rainhorn a publié une tribune dans Le Monde à cette occasion.
Le 13 mai 2025, les responsables de l'opération de rénovation menée en 2009 autour de l'Opéra royal du château de Versailles ont été reconnus coupables de blessures involontaires par violation délibérée d’obligations de sécurité, mise en danger d’autrui et, pour certains, subornation de témoins. Pour cause, les ouvriers employés aux travaux de rénovation ont été directement exposés au toxique sans bénéficier d'aucun équipement ni mesure de sécurité adaptée, et ce, malgré des risques reconnus et l'obligation pour les employeurs de les prendre en charge dans l'espace de travail. Tous ont été gravement contaminés par le plomb à l'époque des faits et ont dû subir des interruptions de travail (ITT) allant pour certains jusqu'à 180 jours. Ils ont pu obtenir gain de cause grâce à la mobilisation du parti civil constitué de quatre anciens ouvriers du bâtiment et l'épouse de l'un deux.
Ce jugement rendu aux termes d'un délai d'instruction de seize ans marque un tournant historique : aucun procès procès pénal d'ampleur n'avait, jusqu'ici, autant mis en évidence la responsabilité des employeurs dans la construction de la négligence et des défaillances face au plomb. Il remet en question cette longue amnésie collective qui s'est construite autour de la dangerosité du toxique et offre, en même temps, l'espoir d'une plus grande responsabilisation des employeurs devant les risques industriels.
L'article, publié le 21 mai 2025, est disponible ici (réservé aux abonnés).

Exposition au plomb : « Le bâtiment est un secteur où la sécurité des ouvriers est tout le temps bafouée » (Entretien)
À l'occasion des assises de la santé et de la sécurité des travailleurs et des travailleuses qui se sont déroulées le 25 et 26 mars à la bourse du travail de Paris, l'historienne Judith Rainhorn a accordé un entretien à L'Humanité pour revenir sur l'exposition au plomb dont souffrent encore de nombreux ouvriers et ouvrières en France. Alors que les dangers de ce toxique sont bien connus et que la loi a intégré des dispositifs multiples pour en protéger les travailleurs et travailleuses, comment expliquer que de nombreux cas d'intoxication persistent ? L'autrice de Blanc de plomb. Histoire d'un poison légal (Presses de SciencesPo, 2019) dévoile des mécanismes et des rhétoriques similaires à celles qui ont justifié une exposition dans les décennies précédentes, signes que des formes de déni et d'accommodement avec le toxique sont encore bien présentes sur les chantiers.
Article publié le 26 mars 2025 et consultable ici (réservé au abonnés).

"Incendie de Notre-Dame de Paris : une catastrophe utile dans la lutte contre le plomb" (Tribune)
Dans cette tribune publiée dans Libération, l'historienne Judith Rainhorn revient sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris et sur le choix de rebâtir la flèche et le toit du monument en plomb - à l'identique - malgré les propriétés hautement toxiques du matériau. Aux côtés de Jacky Bonnemains, directeur de l’association Robin des bois et Lex van Geen, géochimiste (Columbia University New York), Judith Rainhorn rappelle les problèmes posés par la réutilisation de ce matériau : ses propriétés hautement cancérigènes et nuisibles pour la reproduction, sans seuil minimal d'exposition, en font un élément particulièrement dangereux. La revue scientifique The Lancet Planetary Health évaluait à 5,5 millions le nombre de morts (adultes) pendant l'année 2019 liées à des maladies cardio-vasculaires provoquées par l’exposition au plomb (selon une étude publiée le 12 septembre 2023). Alors que la destruction de la flèche et d'une partie du toit de la cathédrale avait libéré 400 tonnes de plomb dans l'atmosphère de Paris - conduisant d'ailleurs plusieurs associations à considérer le monument en cendres comme un "déchet toxique" - l'utilisation d'un autre matériau pour la reconstruction avait été avancé par l'historienne comme un moyen d'avancer dans la mise au ban du cancérigène.
Malgré ce rendez-vous manqué par l’État, le chantier a tout de même permis "une mobilisation et une surveillance accrue de cet ennemi majeur de la santé humaine". Cette tribune est l'occasion de revenir sur les étapes et les moments de la conscientisation du risque lié au plomb et d'interroger l'état actuel de la lutte contre cet élément encore bien trop présent dans notre environnement.
Article publié le 06 décembre 2024 et consultable ici (réservé aux abonnés).
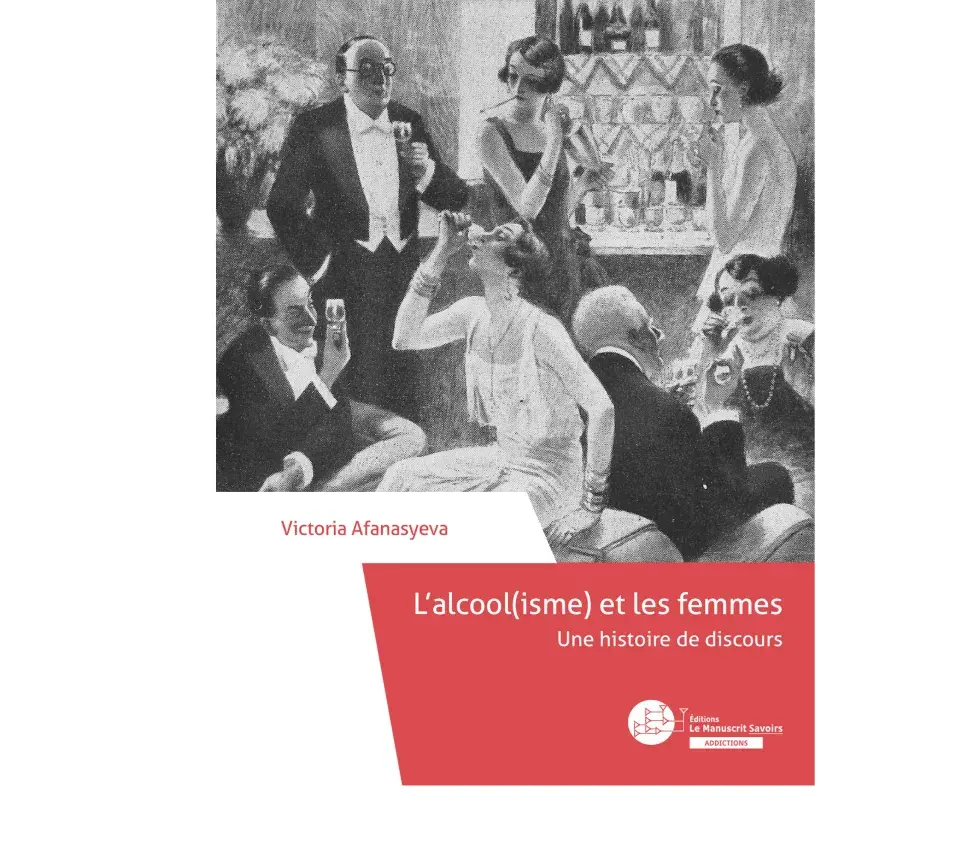
L'alcool(isme) et les femmes : une histoire de discours
L'historienne Victoria Afanasyeva, spécialiste de l'histoire du mouvement antialcoolique français et du rôle des femmes dans la lutte contre le fléau entre le XIXe et le XXe siècles, vient de publier l'ouvrage L'alcool(isme) et les femmes : une histoire de discours (éditions Le Manuscrit).
Comme l'explique son auteure, le livre s'intéresse aux prises de parole féminines sur un sujet aussi complexe que l'alcool(isme), depuis la fin du XIXe siècle avec le mouvement antialcoolique naissant, jusqu'à la fin du XXe siècle. Il cherche à circonscrire, au prisme de ces discours, la catastrophe que décrivent les médias français dans les années 1980, « l'alcoolisme chez les femmes ». Et ce, au moment même où guéries, les buveuses commencent à prendre la parole - à la radio, dans l'émission Les problèmes du coeur animée par Menie Grégoire, puis à la télévision, avec Laure Charpentier, écrivaine et première femme ancienne malade à se présenter au petit écran à visage découvert.
À la croisée de l'histoire des femmes, du genre, de la médecine, des addictions, des médias et des associations, l'argumentaire de ce livre se déploie en trois parties aux titres empruntés au vocabulaire de la Croix-Bleue. Importée de la Suisse en France en 1883, cette association protestante milite pour l'abstinence totale et s'occupe du « relèvement des buveurs » : c'est la précurseure des Alcooliques anonymes. Trois motifs d'adhésion sont arrêtés pour ses membres : « pour encourager les faibles », à l'intention de ceux qui ne boivent pas et veulent donner un exemple aux autres ; « pour se préserver ou pour d'autres motifs », afin de limiter sa consommation et aider ceux qui ont une personne malade dans leur entourage ; et « pour se corriger », pour les alcooliques. Ces expressions sont ainsi utilisées pour caractériser les discours féminins : ceux des militantes engagées volontairement, ceux des épouses souffrant des abus de leurs maris, enfin, ceux des buveuses nécessitant du soutien.
Victoria Afanasyeva est cheffe du pôle addictions de l'Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP), coordinatrice du projet MALCOF (Mouvement antialcoolique français) et ex-IGE au Centre d'histoire du XIXe siècle à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a soutenu la thèse Cherchez la femme : histoire du mouvement antialcoolique en France (1835-2013) sous la direction de Myriam Tsikounas en 2020.
Date de publication : 02/09/2024
ISBN : 9782304056006
Nombre de pages : 208
Prix : 17,00 €